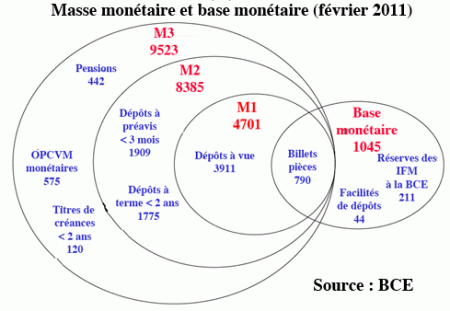mercredi, 08 août 2012
Michel VOLLE & XERFI: De l’économie à l’iconomie
mercredi 8 août 2012
De l'économie à l'iconomie
http://michelvolle.blogspot.fr/2012/08/de-leconomie-licon...
L’« iconomie » est le système économique qui permet aux consommateurs, aux entreprises, aux institutions et à l’État de tirer pleinement parti du système technique fondé sur l’informatique, l’Internet et l’intelligence partagée. Passer de l’économie à l’iconomie, c’est adopter un nouveau modèle de compréhension de l’économie. Ce modèle permet de définir une orientation stratégique pour la compétitivité, la croissance et la renaissance de la France.
* *
L'Institut Xerfi s'est donné pour but d'éclairer les voies d'un retour à la compétitivité et à l'équilibre des échanges de la France. Il faut pour cela que notre pays s'oriente vers l'iconomie en adaptant ses entreprises, ses institutions, au monde nouveau qui s'est créé sur le socle physique que fournit le « numérique » avec l'informatisation et la mise en réseau des institutions, du système productif et de la vie personnelle [1].
Si cette adaptation échoue la France perdra son droit à la parole dans le concert des nations : elle sera dominée et colonisée comme le furent au XIXe siècle les pays qui avaient refusé l'industrialisation. Le monde lui-même y perdra l'expression de cet « élitisme de masse » qui est la marque de notre République et de ses valeurs [2].
* *
Il ne faut pas s'y tromper : le numérique n'introduit pas dans notre société une évolution mineure que l'on puisse maîtriser en ne considérant que les transformations introduites par l'Internet dans les droits d'auteur et l'économie des médias.
Il nous fait franchir un intervalle aussi large que celui qui a séparé naguère la société rurale et féodale de l'ancien régime de celle, industrielle et bourgeoise, qui s'est déployée après la Révolution .
Le numérique automatise en effet progressivement toutes les tâches répétitives, qu'elles soient intellectuelles ou manuelles : les usines se vident d'ouvriers pour se remplir de robots. En outre la puissance et la rapidité des ordinateurs, l'ubiquité de l'Internet, l'intelligence incorporée dans les programmes ont élargi le domaine du possible et, corrélativement, suscité des dangers nouveaux.
Ce saut qualitatif vers l'iconomie bouleverse les conditions pratiques de l'action productive et donc les entreprises, le marché, les formes de la concurrence et plus généralement toutes les institutions.
* *
On peut dater du milieu des années 1970 le début de cette évolution. Elle a été alors ressentie plus que comprise et la stratégie, saisie par une sorte d'affolement, s'est orientée de façon cohérente mais malencontreuse au rebours de ce qu'il aurait fallu faire pour tirer parti du numérique et se prémunir contre les risques qu'il comporte :
- alors que dans l'iconomie la compétitivité se gagne, par l'innovation, en conquérant un monopole temporaire sur un segment des besoins, les entreprises françaises ont misé sur la production de masse de produits standards et sur la concurrence par les prix ;
- alors que les consommateurs doivent se procurer des « effets utiles » en choisissant selon le rapport qualité / prix, ils ont été incités à rechercher systématiquement le prix le plus bas ;
- alors que les produits doivent être des assemblages de biens et de services, la production des biens a été délocalisée vers des pays à bas salaires et les services qui doivent les accompagner ont été négligés ;
- alors que la production doit être réalisée par un réseau de partenaires, une sous-traitance brutale a été généralement préférée au partenariat entre égaux ;
- alors que l'entreprise emploie non plus de la main d’œuvre mais du « cerveau d’œuvre », elle a continué à imposer à celui-ci un rapport hiérarchique autoritaire qui le stérilise ;
- alors qu'en France c'est l’État qui a créé la nation et qu'il est l'« institution des institutions [3] », son rôle stratégique a été nié pour faire place à la concurrence pure et à l'autorégulation du marché ;
- la réglementation européenne, adhérant à ce dogme libéral, a rompu la cohésion des infrastructures (télécoms, chemins de fer, électricité etc.) en répartissant leurs organes entre plusieurs entreprises qui se disputent le résultat ;
- alors que l'endettement de la nation résulte de l'accumulation du déficit de la balance des transactions courantes, l'attention s'est focalisée sur la dette de l’État.
Les entreprises ont été victimes de cette stratégie :
- le secteur financier, mondialisé grâce aux réseaux télécoms et automatisé, a été déchaîné par la dérégulation et incité à « produire de l'argent » en parasitant le système productif ;
- la délocalisation a pérennisé des techniques obsolètes et retardé l'investissement que demande l'automatisation ;
- l'effort de R&D s'est le plus souvent limité, en France, à la mise en évidence d'idées judicieuses en laissant à d'autres pays le soin d'industrialiser les produits qui les exploitent ;
- comme les services bancaires informatisés blanchissent efficacement les profits du crime organisé, celui-ci s'efforce de contrôler le système productif et rivalise avec l’État pour instaurer un pouvoir politique de type féodal.
L'ensemble de ces dispositions a créé les conditions d'une crise économique durable ou, comme disent les économistes, d'un « déséquilibre ».
Il en est résulté un désarroi dans l'opinion commune : alors que chacun estime avoir droit à la satisfaction de ses besoins et au statut social que confère un emploi, nombreux sont ceux qui se disent hostiles à la science, à la technique et aux entreprises qui les leur procurent.
Une autre idéologie, tirant prétexte du respect dû à la nature, prétend qu'une « décroissance » s'impose.
* *
Cependant les pays émergents, affranchis des habitudes et préjugés qui entravent chez nous les institutions en place, se sont lancés hardiment dans le numérique et ont conquis l'avantage compétitif. Ils n'adhèrent assurément pas à l'idéologie de la décroissance !
Certes, la rapidité de leur évolution résulte pour partie d'un rattrapage et elle s'accompagne de tensions sociales et de dégâts déplorables dans l'environnement : il ne s'agit donc pas de les prendre pour modèle, mais ils montrent ce que le numérique rend physiquement possible pour peu que l'on sache surmonter les limites et blocages qui entravent nos institutions, les préjugés qui inhibent notre jugement.
Il s'agit ainsi de renverser l'ensemble des orientations stratégiques qui ont prévalu depuis les années 1970, et que nous avons énumérées ci-dessus, pour orienter l'économie – et, plus profondément, la société tout entière – vers l'iconomie.
La France dispose d'atouts qui peuvent lui permettre de reprendre l'initiative et de montrer la voie à l'Europe : un niveau culturel et scientifique élevé, l'existence d'un « honneur professionnel porteur de devoirs qu'on ne peut négliger sans déchoir [4] » qu'accompagnent le goût de l'initiative et de la recherche de solutions, la fierté du beau produit, le désir de performance.
1) Il faut d'abord restaurer, dans l'opinion commune, la place qu'occupent la science, la technique et l'entreprise : chacun doit comprendre que la consommation doit être collectivement gagée par une production et que l'entreprise est le lieu naturel de l'action productive.
Le rôle crucial du numérique dans la société et dans l'économie exige que le système éducatif s'y adapte, en introduisant à tous les stades de l'école, du collège et du lycée des enseignements d'informatique destinés à initier les élèves aux aspects les plus fondamentaux de cette discipline, notamment à la programmation, qui en est le centre.
L'iconomie va de pair avec une consommation sobre, sélective et attentive à la qualité des produits, et avec des entreprises qui traitent leurs déchets et recyclent leurs produits en fin de vie : cela ouvre la perspective d'une « croissance intelligente », respectueuse de la nature et capable de répondre aux exigences les plus élevées de l'écologie.
2) Les entreprises doivent être incitées à s'organiser conformément à l'iconomie :
- conquérir par l'innovation un monopole éventuellement temporaire sur un segment de clientèle dont on aura identifié et anticipé les besoins ;
- le conforter par la pratique vigilante du secret et par un renouvellement continu de l'innovation tirant parti des progrès de l'informatique et des nouveaux matériaux ;
- associer enfin à chaque produit les services qui renforcent sa qualité et assurent la satisfaction du client : maîtrise des délais d'approvisionnement, dépannage et maintenance, information et formation, remplacement et recyclage en fin de vie etc.
Le réalisme les invite en outre à instaurer un échange équilibré de la considération avec leurs salariés, clients, fournisseurs et partenaires : c'est une condition nécessaire de l'efficacité de l'action productive lorsqu'elle est réalisée par un réseau de « cerveaux d’œuvre ».
Contrairement à ce que l'on dit souvent, l'effort ne doit pas concerner seulement les PME et autres ETI : les grandes entreprises du CAC40, voire du « CAC400 », sont autant de têtes de réseau qui assurent une fonction stratégique d'orientation. La qualité sémantique et pratique du système d'information, qui assure et contrôle la qualité du produit jusque dans les mains du consommateur, doit être le premier souci de leur dirigeant.
3) L’État a lui-même une responsabilité d'entrepreneur envers les grands systèmes de la nation (système éducatif, de santé, judiciaire, de défense, législatif etc.). Il doit sans relâche rappeler les institutions concernées à leur mission et les inciter à s'affranchir des habitudes, procédures et formes d'organisation qui répondaient au système technique antérieur mais sont aujourd'hui obsolètes. L'appel à l'honneur professionnel et le témoignage de respect envers les valeurs attachées à la mission seront ses meilleurs arguments.
L’État doit aussi veiller à ce que l'économie dispose des infrastructures nécessaires : même si cela suppose de contredire les institutions européennes, il devra restaurer la cohésion des réseaux tout en les encadrant par une régulation attentive au bien commun.
Envers les entreprises et le secteur privé lui-même l’État doit remplir son rôle d'institution des institutions : d'abord en faisant en sorte que les entreprises où il détient une part significative du capital soient d'une efficacité exemplaire, puis en utilisant les leviers que lui procurent son rôle réglementaire, son rôle financier et son rôle d'acheteur.
Enfin, les dangers que le numérique apporte doivent être identifiés et combattus résolument : cybercriminalité, blanchiment informatisé, automatisation excessive, manque de sécurité et de fiabilité etc.
* *
Pour pouvoir passer à l'action, la stratégie dont nous donnons ici une esquisse devra être précisée selon les domaines où elle doit s'appliquer. C'est la mission que se donne l'Institut Xerfi, et qui orientera ses travaux dans les prochaines années.
_____
[1] Bertrand Gille, Histoire des techniques, Gallimard, La Pléiade, 1978.
[2] Philippe d'Iribarne, La logique de l'honneur, Seuil, 1993.
[3] Maurice Hauriou, La théorie de l'institution et de la fondation, 1925.
[4] Philippe d'Iribarne, L'étrangeté française, Seuil, 2006, p. 87.
18:17 Publié dans Numérisation de la société | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
mercredi, 25 juillet 2012
Risque systémique - Dernière lettre de Graham Summers & assortie interview Olivier Demarche 10 juillet sur la récession
http://reflets.info/le-lapin-le-lapin-le-lapin/
it’s clear now that the world is entering a period of wealth destruction. Europe is in the midst of a sovereign debt crisis. History tells us that this will entail more than one sovereign nation going belly-up. Indeed, I believe that we’ll see ALL of the PIIGS as well as France stage sovereign defaults in the coming months.
After that will come Japan, then finally the US. By the time the smoke clears, we will have seen systemic collapse.
This will mean:
1) Many major banks disappearing, as well as numerous potentially lengthy bank holidays (think Argentina in 2001)
2) Multiple sovereign defaults as well as broad economic contractions and their commensurate unemployment/ civil unrest/ erasure of retirement accounts/ pensions (this process has already begun in some US municipals, e.g. San Bernandino and Stockton California as well as Harrisburg Pennsylvania).
3) Possibly new currencies being introduced or new denominations of currencies (say one new unit being worth 1,000 of the old one)
4) Massive wealth destruction to the tune of tens of trillions of Dollars (think MF Global i.e. the money is gone… only systemically… in fact we just had another such instance with PF)
5) A global contraction that will result in new political/ power structures being implemented as well as the breakup of various countries/ unions.
6) Very serious trade wars to begin (see Obama’s recent attack on China) and very possibly a real war.
If the above make you frightened, you’re not alone. As I’ve dug deeper and deeper into the inner workings of the global financial system over the past months, the information I’ve come across has only gotten worse. I’ve been holding off writing all of this because up until roughly April/May it seemed possible that the world might veer towards another outcome.
I no longer view this to be the case. I am almost certain that what I’ve written above will come to pass. I know that much of what I’ve written to you in the past could be labeled as “gloom and doom.” However, I want you to know that I do not use the words “systemic collapse” lightly. Indeed, I wish I wasn’t mentioning them now, but I’d be doing you a disservice not to bring them up because we’re well on our way towards it.
Interview de Olivier Delamarche
04:18 Publié dans Économie, Finance, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
samedi, 14 juillet 2012
SLATE.fr Le scandale du Libor aura-t-il enfin raison de la crédibilité des banques?
http://www.slate.fr/story/59239/banque-scandale-libor-cre...
Pendant des années, l'un des taux mondiaux de référence (Libor) a été manipulé délibérément par de grandes banques anglaises... dans leur seul et unique intérêt.
Le Libor (London Intebank Offered Rate, ou taux interbancaire) ne vous intéresse pas? Peut-être – mais sachez bien que lui s’intéresse à vous. Il y a certes bien peu de chance pour qu’un Américain moyen fasse une demande de prêt interbancaire à Londres; reste qu’une large gamme d’autres instruments financiers prend ce taux pour référence.
Les prêts à taux d’intérêts variables (prêts étudiant privés, crédits auto, emprunts-logement à taux ajustables, cartes de crédit, etc.) doivent être indexés sur un repère fondamental indiquant les coûts globaux des financements au sein du système financier. Il s’agit souvent du «taux de base» fixé aux Etats-Unis, mais le Libor fait lui aussi fréquemment figure de repère.
Si – comme tendent à le prouver de plus en plus d’éléments – le Libor a été manipulé délibérément (et pendant plusieurs années) par certaines banques, alors des millions de personnes ont bel et bien fait l’acquisition de produits financiers (de tous types) à un taux d’intérêt inadéquat. Des personnes innocentes ont été injustement délestées de larges sommes d’argent, tandis que d’autres ont profité d’aubaines tout aussi importantes – et tout aussi injustes. La structure de base du système financier mondial s’avère une fois de plus totalement inadaptée à sa fonction.
Des données fantaisistes
Le Libor est calculé par Thomson Reuters (agence de presse spécialiste de l’information financière) pour la British Bankers’ Association, à partir des informations fournies par les banques faisant partie de la BBA. Ces informations ne s’appuient pas sur les taux réels des prêts interbancaires: les banques se contentent de réaliser une estimation de ce qu’elles devraient débourser en cas de transaction. Les estimations les plus faibles et les plus élevées sont écartées, on réalise la moyenne du reste – et c’est ainsi que l’on obtient le Libor.
Vous estimez peut-être que les données économiques de ce type sont loin d’être solides - et vous avez raison. Car c’est là une simple supposition, pas une véritable mesure. Elle est formulée par une association professionnelle, pas par un organisme de régulation. Elle est par ailleurs auto-déclarée, et ne s'appuie donc sur aucune donnée librement accessible. Au fil des décennies, le Libor a toutefois fini par occuper un rôle fondamental dans la conduite des transactions économiques. Dans un monde de grandes sociétés de services financiers aux multiples facettes, les excentricités inhérentes au processus de détermination du Libor ne pouvaient que se terminer en conflit d'intérêt. Au sein d’une même banque de la BBA, une division pouvait fonctionner normalement, et diffuser ses données Libor quotidiennes sans se mêler des affaires des autres – tandis qu’une autre négociait des contrats d'échange de taux d'intérêt, des contrats à terme sur devises ou d'autres produits dérivés. Précisons que le succès ou l'échec futur de certaines de ces transactions pouvaient tout à fait dépendre d'une hausse ou d'une baisse du Libor. Seulement, voilà: ce dernier n'est pas une donnée extérieure aux activités des banques, et il est tout sauf une évaluation objective. Une banque pouvait ainsi tenter d'adapter les données qu'elle fournissait à l'agence Reuters aux besoins de sa salle de marchés, plutôt que de lui communiquer des estimations de bonne foi.
Manipulations
Or, selon les premières conclusions des enquêtes menées aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, c'est très précisément ce qui s'est passé. A ce stade, la grande majorité des informations compromettantes dont nous disposons proviennent d'une seule banque: Barclays. Non parce qu'elle était la seule à tricher, mais bien parce que ses dirigeants ont décidé de balancer leurs confrères en coopérant avec les enquêteurs. Pour l'heure, les meilleurs documents relatifs au scandale demeurent cette série d'emails désopilants que se sont échangés les traders de la banque et les employés chargés de rédiger les estimations Libor. Citons le message d'un trader, qui remercie un collègue d'avoir trafiqué les chiffres à son avantage: «Mec, je te dois une fière chandelle! Passe après le boulot un de ces jours, j'ouvrirai une bouteille de Bollinger».
Lorsque l'économie mondiale a basculé dans la crise, la manipulation des chiffres du Libor est devenue plus inquiétante. En principe, les taux des prêts interbancaires en vigueur sont un excellent outil de mesure de la santé du système bancaire dans son ensemble. Des taux faibles indiquent que les banquiers accordent une grande confiance à leurs confrères ; les taux de prêts publiés transforment donc des ragots d’initiés en informations publiques. Mais pendant la crise, les régulateurs britanniques semblent avoir encouragé les membres de la BBA à sous-estimer collectivement leurs estimations, de manière à maintenir l’illusion d’une bonne santé financière.
Cette sous-estimation collective pourrait certes être justifiable: en termes de régulation, cette méthode était peut-être au monde de la finance ce que le code rouge est à l’armée américaine. Qu’est-ce qu’une poignée d’entorses aux règles en vigueur face aux répercussions désastreuse qu’engendrerait une crise bancaire de nature systémique?
Un monde de Banksters (banquiers gangsters)
En revanche, la diffusion de données modifiées dans le seul but de dégager des profits en salles de marchés est un parfait exemple du type de situations qui nous expose au risque de nouvelles crises financières. Précisons: le fait qu’un grand nombre de personnes aient perdu de grosses sommes d’argent à la suite d’une surévaluation délibérée des taux d’intérêt n’est pas, en soi, le véritable problème. Ces gens ont bel et bien perdu de l’argent, et ces pertes vont visiblement faire l’objet de procès de grande ampleur. Le vrai problème, c’est que la finance internationale s’est muée en compétition impitoyable. Les firmes font des pieds et des mains pour dénicher de nouvelles (et meilleures) possibilités de profit. Dans le même temps, une bonne partie du système n’est pas encore sortie de l’époque où l’élite - et son réseau – était aux commandes, et où les mesures étaient mises en œuvre sur le mode de l’accord tacite (ou «gentleman’s agreement»).
En décidant de calculer le Libor à partir d’informations recueillies de façon relativement informelle, on a créé une puissante possibilité d’arbitrage: toute banque désirant abuser de l’accord tacite pouvait générer des profits conséquents et sans risques. Et les professionnels acharnés de la finance d’aujourd’hui sont des virtuoses de l’arbitrage – et s’en servent pour contourner les instances de surveillance et de régulation (aussi efficaces soient-elles), avec une aisance des plus terrifiantes.
On ne compte plus les problèmes provoqués par des banquiers qui, à force de ruse et d’inventivité, étaient parvenus à saper les intentions des systèmes de régulation. L’affaire du Libor a mis en évidence une vérité simple, mais rarement exposée de la sorte: lorsqu’il y a de l’argent à la clé, une banque moderne est tout à fait disposée à mentir. Dans l’establishment économique, l’affaire en a scandalisé plus d’un, notamment en Grande-Bretagne; The Economist a même fini par lui consacrer une couverture saisissante, qualifiant les banquiers mis en cause de «Banksters».
Pour l’heure l’onde de choc n’a pas encore atteint l’autre côté de l’Atlantique, mais il faut espérer qu’elle arrivera bientôt. Les Etats-Unis ont certes adopté une importante modification de leur système de régulation financière en 2010; reste à savoir s’ils sont parvenus à modifier l’attitude du système de régulation en elle-même.
L’affaire du Libor est riche d’enseignements:
- les régulateurs doivent comprendre que les banquiers ont tiré un trait sur les valeurs des élites d’antan, et ils se doivent d’ajuster leurs décisions en conséquence.
- Les banques s’efforcent de respecter la lettre de la loi, mais s’engouffrent sans remords dans toutes les brèches – en employant des méthodes malhonnêtes si besoin est.
- Les gendarmes de la finance doivent faire preuve d’une extrême méfiance envers les entités régulées.
Les propositions de renforcement de la régulation des affaires sont souvent critiquées; certains affirment ainsi qu’une plus grande rigueur pousserait l’activité économique vers des places financières étrangères. A court terme, ce serait certainement le cas.
Les banques voudront s’établir sur la place la moins susceptible de sanctionner ses transactions douteuses. Mais à quoi bon transformer son pays en terre d’accueil pour banquiers malhonnêtes? Cette stratégie de développement économique finira forcément par engendrer un système financier rongé par la fraude. L’heure n’est plus à la surprise. Regardons la réalité en face: nous ne faisons que récolter les fruits d’un système de régulation qui, par essence, est vicié.
Traduit par Jean-Clément Nau
20:05 Publié dans Finance | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Slate.fr Economie de la connaissance: les défaillances du génie français
http://www.slate.fr/story/59135/economie-connaissance-def...
Créativité, recherche, aide aux PME innovantes, voilà les pistes tracées par François Hollande pour la croissance européenne qu’il appelle de ses vœux. Qui ne saluerait pas ce programme? On peut se demander toutefois s’il ne s’agit pas d’un plaidoyer pro domo, visant à réparer les défaillances du génie français face à la mondialisation.
En effet, en matière d’investissement dans l’innovation, d’autres pays européens ont négocié ce virage de manière plus efficace que la France, en particulier l’Allemagne.
L’économie de la connaissance comme nouvelle frontière. Sous le soleil de France, ce mot d’ordre est une ritournelle: le lancement de Sophia Antipolis date du début des années 1970, et la politique des pôles de compétitivité, de 2002.
L’appel à l’investissement technologique est une antienne du discours de nos gouvernants, et l’on pourrait imaginer que le pays de Descartes et de Lavoisier emporte le trophée dans ce domaine. Et bien, pas si sûr. Un rapport sur l’indice d’innovation dans les 27 pays européens (Innovation Union Scoreboard, 2011) détruit quelques illusions sur l’excellence de la France, puisque celle-ci occupe seulement le 11e rang du classement.
Fondée sur trois groupes d’indicateurs, les ressources humaines, l’investissement financier et les effets économiques, l’ensemble englobant 25 paramètres, l’analyse de la Commission européenne est impitoyable pour la France. Elle la range non dans le groupe des pays leaders de l’innovation (dans l’ordre: le Danemark, la Finlande, l’Allemagne et la Suède), mais dans le second groupe, celui des suiveurs de l’innovation (dans l’ordre: la Belgique, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, l’Autriche, le Luxembourg, l’Irlande et enfin la France). La comparaison entre l’Allemagne (3e du classement) et la France (11e) est éclairante.

L’Allemagne souffre seulement de deux faiblesses: la proportion de personnes de 30 ans/40 ans dotées d’un diplôme d’études supérieures (d’autres sources montrent que les universités allemandes ne forment pas assez de diplômés, il en manquerait 1 million) et son capital risque.
Mais ses performances sont particulièrement bien équilibrées selon les trois groupes d’indicateurs et on note: un nombre très important de doctorants et de publications scientifiques, l’investissement dans les firmes tant en recherche développement que hors la R&D, les dépôts de brevets, les activités de marché, en particulier dans le cadre communautaire, et les exportations de services de la connaissance.
Les scores de la France se situent dans la moyenne européenne: elle prouve des atouts en ressources humaines (nombre de diplômés du supérieur, d’étudiants non européens et publications), ses investissements dans la recherche développement sont conséquents, mais bien plus modestes que l’Allemagne, elle dispose d’une recherche publique dotée d’un système attractif de financement; mais parallèlement, elle est faible dans les investissement hors R&D ainsi que dans les actifs «en matière grise» (les brevets), et dans l’exportation de services de la connaissance.
Cette étude suggère que l’énorme effort hexagonal dans l’éducation et la recherche se traduit imparfaitement dans de la production d’«actifs intellectuels» et engendre de moindres retombées commerciales qu’au-delà du Rhin. Ainsi, l’Allemagne devance largement la France pour le dépôt de brevets: en 2010, elle a déposé 17.558 brevets tandis que la France en déposait 7.288 (source OMPI). 90% des nouveaux brevets allemands émanent de PME.
Cette ardente obligation en faveur de l’économie de l’intelligence implique la création d’entreprises innovantes:«Par-dessus tout, les chefs d'Etat devront apporter des garanties pour soutenir les jeunes entrepreneurs car ce sont eux qui peuvent générer les nouveaux emplois que toute la jeune génération attend désespérément», affirmait à Challenges John Kirton, directeur du groupe de recherches sur le G8 et le G20, quelques jours avant le sommet du 18-19 juin. Plus encore, la création et la dynamisation des PME constituent un enjeu stratégique puisque l’essentiel des nouveaux emplois en Europe en dépendent (85% pour la période 2002-2010).
L'Allemagne crée moins d'entreprises, mais mieux
Qu’en est-il de la création d’entreprises en France? Le nombre d’entités créées est élevé –549.000 créations en 2011. Mais 94% de ces nouvelles entreprises débutent sans salariés, et souvent elles en restent là: beaucoup d’entre elles, de fait, naissent sous le statut des auto-entreprises.
Si l’on écarte ces dernières, l’état réel de la création d’entreprises en France est plus modeste. La France compte aujourd’hui 2,9 millions de PME qui accueillent 55% de la population active. L’immense majorité de ces PME sont des micro-entreprises. Restent donc 5,7% de PME non micro-entreprises (une trentaine de salariés en moyenne), et 0,1% d’ entreprises de taille moyenne (650 employés en moyenne). 16% du chiffre d’affaires de ces PME va vers l’exportation.
Tout autre est la situation outre-Rhin. En effet, si l’Allemagne voit naître un nombre plus faible d’entreprises (410.000 en 2009), celles-ci démarrent avec plus de salariés, un meilleur soutien capitalistique grâce des fonds qui leur sont dédiés, et grâce à l’aide au recrutement de post-doctorants.
Parallèlement, elles ont une potentialité de développement bien supérieure en raison d’une démarche entrepreneuriale pragmatique qui consiste à exploiter un savoir-faire, à se focaliser sur des produits de niche, et à tirer parti du contexte de la mondialisation.
Au final, l’économie allemande compte 3,6 millions de PME dans lesquelles travaillent actuellement 70% de la population active. Fourmillant de mini-unités comme en France (90% d’entre elles ont moins de 9 salariés), elle comporte néanmoins une plus forte part de grosses PME. Beaucoup de ces grosses entités performantes ont été créées dans les années 1970-80, et reposent sur du capital familial. En ce qui concerne les start-up récentes, il est difficile d’avoir du recul, mais on peut imaginer qu’elles sont conformes au modèle déjà installé. 33% du chiffre d’affaires de ces PME se dirige vers l’exportation, comme l'explique voir Isabelle Bourgeois dans PME allemandes: les clefs de la performance.
Les études se sont multipliées ces dernières années pour saisir les clefs du succès du Mittelstand allemand (tissu d’entreprises petites et moyennes). Un rapport publié en 2011 assène ce diagnostic:
«De nombreux points s’expriment pour “expliquer” l’écart de compétitivité entre la France et l’Allemagne: la qualité des relations clients-fournisseurs, l’image de l’industrie dans l’opinion, les effets de seuils qui dissuadent les entreprises française de grandir, la manie française d’en ajouter sur les réglementations européennes, les difficultés des PME françaises à trouver des financements, l’insuffisance de nombres d’entreprises de taille intermédiaires en France, la meilleure spécialisation industrielle, les charges fiscales et sociales “excessives” en France, l’insuffisance des crédits de recherche et l’innovation de produits…» (Michel Didier et Gilles Koléda,Compétitivité France Allemagne, Le grand écart, Economica, 2011).
Autrement dit, ces joyaux de l’économie allemande se greffent sur une tradition entrepreneuriale et sur une culture locale d’entreprise, mais ils ont été soigneusement accompagnés par des réformes structurelles menées par les pouvoirs publics. Le miracle allemand repose aussi sur la création d’un environnement favorable.
A l’aune de ces données comparatives, on peut se poser une question: en prenant la tête d’une croisade pour la croissance ancrée sur l’économie de la connaissance, un secteur qui va du numérique aux énergies renouvelables, en entendant stimuler les PME et la ré-industrialisation, François Hollande ne se fait-il pas, sans le dire et peut-être sans le savoir, le chantre du modèle allemand? Tout simplement. Car le paradoxe du débat sur la croissance est bien là: qui, en Europe, est le mieux placé pour donner des leçons sur la façon de dynamiser les territoires?
Monique Dagnaud
00:59 Publié dans Compétition, Économie, Industries du futur | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
mercredi, 13 juin 2012
AGORAVOX : La monnaie
Article d’A-J Holbecq
http://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/la-mon...
Souvent reviennent les mêmes questions, les mêmes erreurs, les mêmes incompréhensions, les mêmes arguments erronés. Le but de ce court article est de tenter de vulgariser, aussi simplement qu’il se peut et sans trop entrer dans les détails, la « fabrication moderne de la monnaie »
D’abord, il faut le rappeler:
- sous le terme de monnaie on regroupe tous les moyens de payement plus ou moins « liquides » (bien que souvent il arrive d’utiliser ce terme pour parler de « monnaie manuelle », les espèces qui peuvent se transférer de la main à la main). La liquidité, c’est la faculté pour la monnaie d’être rapidement disponible sans perte de valeur.
- La banque centrale détermine trois niveaux de liquidité qui sont en même temps des « masses monétaires » … celles dont nous (les « agents non bancaires ») nous nous servons pour nos placements à courts ou moyens termes
- M1: qui comprends les espèces (qui sont simultanément comptabilisés dans l’agrégat M0, monnaie de la Banque Centrale) et les Dépôts à Vue (DaV), c’est à dire ce que vous avez dans votre porte monnaie et le solde instantané des comptes courants bancaires>
- M2 qui est l’agrégat intégrant certains livrets d’épargnes (dépôts à terme) en plus de M1″>
- M3 qui est l’agrégat intégrant par exemple des OPCVM
(extrait du blog “les-crises”)
Ce qui est d’une liquidité risquée (difficulté de disposer rapidement de l’épargne), dont le terme est à plus de 2 ans ou qui risque de perdre trop de valeur lors de la transformation vers une forme de forte liquidité (M1) n’est pas comptabilisé par la Banque Centrale sous le terme de « monnaie »; mais il faut bien comprendre qu’il s’agit de simples conventions. Par exemple les anglais calculent un agrégat M4 ce que nous faisions également jusque dans les années 80′, alors que les étasuniens on abandonné la publication de M3, ne considérant plus cet agrégat comme de la monnaie. Nous pourrions aller plus loin comme Pierre Aunac et considérer qu’il n’y a de monnaie QUE dans M1 (M2 et M3 sont des ensembles vides)
Autre point : non, ce n’est pas l’État qui crée la monnaie, non ce n’est pas la Banque Centrale (BCE ou Banque de France (à l’exception des espèces et de la monnaie d’utilisation réservée au système bancaire), non la monnaie n’est pas gagée sur l’or qui serait présent dans les coffres de la Banque de France, non la monnaie n’est plus corrélée à l’or d’aucune manière (et ce, depuis 1971)…
Il était une fois…
L’histoire de la monnaie moderne a commencée en 16xx, principalement à Londres. Les gens fortunés déposaient – en payant un droit de garde – leur or ou leurs autres valeurs chez les orfèvres qui disposaient de coffres bien gardés. L’orfèvre leur signait un reçu nominatif détaillé qui progressivement fut remplacé par un reçu (toujours nominatif) indiquant seulement la valeur des métaux précieux: un « certificat de dépôt »
Plutôt que d’aller rechercher les valeurs métalliques laissés en dépôt chez l’orfèvre pour effectuer leurs paiements à leurs fournisseurs, les déposants prirent progressivement l’habitude d’obtenir de l’orfèvre des certificats de dépôts anonymes, qui, passant ainsi de main en main en tant que moyen de paiement, circulaient dans l ’économie.
Jusqu’ici les certificats de dépôts disposaient d’une couverture totale en métaux précieux et pouvaient sans aucune difficultés être tous échangés par l’ensemble des valeurs détenues dans le coffre de l’orfèvre.
Au fil du temps, les orfèvres font le constat que peu de certificats de dépôts reviennent chez eux pour être échangés; il circulent indépendamment de l’or qui est leur contrepartie. Vers 1675 des orfèvres émettent les premiers certificats de dépôts qui ne sont plus gagés sur de l’or effectivement déposé mais sur une simple reconnaissance de dette (une créance pour l’orfèvre). Par ce double pari ( tous les déposants ne viendront pas chercher leur or simultanément, les gens ignorent la proportion de certificats de dépôts qui ne sont pas couverts par des valeurs métalliques), ces orfèvres devinrent banquiers.
Et maintenant ?
Imaginez que vous soyez dans un pays où il n’y a qu’un seul réseau bancaire (Réseau A) et pas de banque centrale. Un entrepreneur va voir le banquier et lui demande 1 milliard d’unités monétaires. De la même manière que l’orfèvre devenu banquier émettait des certificats de dépôts en échange d’une reconnaissance de dette, le banquier va émettre un certificat de dépôt d’1 milliard au bénéfice de l’entrepreneur, en créditant le « compte à vue » de celui ci, et c’est devenu de la « monnaie » avec laquelle l’entrepreneur pourra effectuer ses paiements: ce dépôt à vue au compte de l’entrepreneur est inscrit en « passif » au bilan du banquier (nous verrons pourquoi). En garantie de remboursement au terme donné (ne parlons pas pour le moment des intérêts) l’entrepreneur amènera une hypothèque, une caution, un nantissement, sa reconnaissance de dette, etc, – c’est le banquier qui décide quelle garantie il accepte – que le banquier portera à l’actif de son bilan; les deux opérations ont lieu simultanément. On dit que le banquier monétise des actifs non monétaires pour créer de la monnaie dite secondaire (monnaie de réseau bancaire A, comme, nous le verrons ensuite, il peut exister des monnaies de réseau bancaires B, C, D, etc…)
Puisque (par hypothèse dans ce début d’explication) il n’y a qu’un seul réseau bancaire, tous les fournisseurs, les employés, les consommateurs ont leur compte bancaire dans ce réseau; la monnaie ne passe en fait que d’un compte à l’autre et, pour le remboursement il faudra qu’elle revienne totalement à l’entrepreneur (et ce jour là il n’y aura plus de monnaie du tout).
Si c’était aussi simple, vous voyez que le réseau bancaire unique n’aurait aucune difficulté à émettre toute la monnaie qu’il veut… par simple « monétisation » d’un actif non monétaire qui peut prendre plusieurs formes (obligation, immobilier, oeuvre d’art, etc,).
Mais dans la réalité ce réseau bancaire n’est pas seul (il a des concurrents), les Etats leur ont imposé des règles prudentielles (règles de « prudence »), et une banque centrale chapeaute leur activité en se réservant l’émission de monnaie centrale (dite aussi monnaie de base, dont nous utilisons un type: la monnaie manuelle que sont nos actuels billets de banque).
Voyons tout cela.
La plus importante des règles prudentielle est issue des règlements dits « de Bâle » (Bâle 2, Bâle 3). Elle impose que les crédits émis par un réseau bancaire ne dépasse pas 8% de ses fonds propres, ce qui a pour conséquence que l’émission de crédit ne peut, toujours pour ce réseau bancaire donné, ne pas dépasser 12,5 fois ses fonds propres.
La Banque Centrale de son coté impose d’abord à chaque réseau bancaire d’assurer la distribution de sa monnaie, la « monnaie fiduciaire » ( ou espèces ou monnaie manuelle: vous constatez que nous avons jusqu’ici évité d’utiliser le terme de « monnaie fiduciaire » souvent utilisé pour désigner les espèces; la raison en est seulement que ce terme est issu du mot latin « fidus » dont la signification est « confiance » ; n’aurions-nous confiance que dans la monnaie émise par la Banque Centrale?) . Les réseaux bancaires doivent de ce fait se procurer cette monnaie fiduciaire à la Banque Centrale qui va la créer, par un processus identique à celui de la création de monnaie secondaire par les réseaux de banques commerciales, en déposant une obligation (obligation dite « éligible ») à l’actif de la Banque Centrale, laquelle portera à son passif cette monnaie fiduciaire qu’elle confiera aux banques commerciales pour satisfaire la demande de la population (en se souvenant que, évidemment, les banques ne vous échangeront cette monnaie centrale que contre un diminution de leur dette envers vous, c’est-à-dire une diminution de votre compte courant. La demande constatée des espèces est de l’ordre de 13% des dépôts ; elle est variable selon le lieu (ville ou campagne), selon la période (semaine, weekends, vacances, fêtes), selon les pays et les habitudes.
La Banque Centrale va aussi imposer aux banques commerciales de déposer – toujours en monnaie centrale (mais cette fois « monnaie scripturale » ou électronique) sur leur compte (toutes les banques commerciales sont tenues de disposer d’un compte en Banque Centrale) un montant correspondant à un certain pourcentage des dépôts de leurs clients: il s’agit des réserves obligatoires ». Ici une précision importante s’impose: on lit ou on entends souvent une imprécision sous la forme « les banques commerciales doivent bloquer X% des dépôts de leurs clients sur leur compte en Banque Centrale », et le lecteur pourra penser qu’une partie des dépôts des clients ou épargnants serait transférés sur la Banque Centrale! Non, ce n’est pas le cas: il n’y a aucun « passage » de la monnaie secondaire vers de la monnaie de base et les comptes des déposants ne sont pas bloqués ni transférés; c’est bien l’équivalent de X% des dépôts qui se retrouve en Banque Centrale et non une partie des dépôts.
Actuellement (début 2012), ce taux de réserves obligatoire est, dans la zone euro, de 1%, mais il peut varier suivant les desiderata de la Banque Centrale (en Chine il est d’environ 20%); c’est un des moyens dont dispose la Banque Centrale – avec le taux dit « de refinancement » - pour faciliter ou limiter l’émission de crédit.
Nous disions aussi que les différents réseaux bancaires ne sont, par définition, pas seuls dans leur coin à émettre leur propre monnaie dont leurs seuls clients se serviraient: il y a bien une « interconnectivité » de ces monnaie (lorsque vous utilisez les euros de votre compte vous ignorez si l’origine de la création monétaire de « ces » euros est celle de votre réseau bancaire ou d’un réseau concurrent qui aurait abouti au final sur votre compte lors de paiements de fournisseurs, de salaires ou autres échanges commerciaux.
Mais comment se fondent en une seule « unité » ces euros d’origine BNP, SG, Crédit Mutuel, CA ou autres ? C’est simplement parce que les banques commerciales, en elles, n’acceptent que des paiements sous forme de monnaie centrale et les « compensations » lorsqu’elles sont négatives (solde dû d’un réseau bancaire à un autre réseau bancaire) correspondent au troisième besoin de monnaie centrale pour les banques commerciales.
Résumons:
a) les réseaux des banques secondaires émettent la monnaie dite « de crédit » par simple monétisation d’actifs (nous verrons que les banques peuvent aussi émettre de la monnaie pour compte propre)
b) la monnaie est simplement un moyen d’échange basé sur la confiance dans le système bancaire qui garanti que la monnaie « secondaire » qui circule pourra à tout moment être échangée en cette monnaie d’une « qualité » supérieure, celle de la Banque Centrale.
c) l’ensemble des besoins de monnaie centrale pour les banques commerciales (appelé aussi « les fuites ») sont:
- les besoins d’espèces
- les besoins correspondants aux réserves obligatoires
- les besoins de compensation envers leurs concurrents.
Nous pouvons maintenant entrer dans les détails.
Plutôt que de suivre l’habituelle démonstration que vous trouvez dans tous les ouvrages universitaires sur la monnaie, qui commencent par l’explication de la création monétaire par un réseau bancaire, puis par deux, puis avec l’introduction de la Banque Centrale, nous allons essayer de vous faire comprendre globalement le système.
Nous avons vu que si l’on considère l’ensemble des réseaux bancaires ceux ci sont soumis à deux types de besoins de monnaie centrale (réserves obligatoires et satisfaction des demandes des agents non bancaires en « monnaie manuelle », tels les ménages et les entreprises ). Le troisième type de « fuite », les soldes de compensations entre réseaux bancaires, s’annulent, les soldes créditeurs des uns envers leurs concurrents étant équilibrés par les soldes débiteurs des autres; on peut en fait considérer que nous sommes dans un système à un seul réseau bancaire ET une banque centrale.
Admettons ici que la demande de billets plus les réserves obligatoires représentent un total de 20% des dépôts (donc des crédits accordés sur une certaine période). Si ce réseau bancaire unique a émis 100 de crédits, il va devoir obtenir 20 de la Banque Centrale, de cette monnaie qu’il ne peut lui même produire: on dit que son coefficient multiplicateur de crédit est de 5 (on peut, en inversant le sens de causalité, considérer que la Banque Centrale est « obligée » de fournir les 20 demandés par les banques – simplement pour éviter un blocage du système -, et on parle dans ce cas de « diviseur »).
Si (autre exemple) nous avions une demande de billets de 10 plus les réserves obligatoires de 1, le coefficient multiplicateur devient 9 (100 divisé par 11)
Ces coefficients représentent la capacité de création monétaire, pas nécessairement ce qui est constaté en réalité.
Note 1 : comme l’écrit la Banque des Règlements Internationaux : « le niveau de réserves n’influe qu’à peine les décisions par les banques de prêter. Le montant de crédits en cours est déterminé par l’empressement des banques de fournir des prêts, fondée sur le compromis profitabilité/risque perçu, et par la demande pour ces prêts. La disponibilité globale des réserves ne contraint pas directement l’expansion du crédit. La raison est simple : comme expliqué dans la Section I, lors du graphique I – de loin le plus commun – afin d’éviter une volatilité extrême du taux d’intérêt, les banques centrales fournissent des réserves sur demande du système. Dans cette perspective, un minimum obligatoire de réserves, en fonction de leur rémunération, affecte le coût de l’intermédiation de ces prêts, mais ne contraint pas l’expansion du crédit quantitativement. »
Note 2 : Reconnaissons que nous avons simplifié légèrement : les chiffres exacts dans ces deux exemples sont de 5,26 et 9,09 car la formule exacte du multiplicateur est K= 1 / [X + Z (1 – X)] avec coefficient de préférence pour les billets et Z le coefficient de réserves obligatoire; cette différence est due au fait que les fuites de demande de monnaie fiduciaire sont calculées sur les crédits alors que les réserves obligatoires sont calculées sur les dépôts…. mais ce qui est important à connaître ce sont les ordres de grandeur
Si on fait intervenir différents réseaux bancaires en notant Y la part de marché de crédits des autres réseaux bancaires, la capacité multiplicatrice d’un réseau A est, en prenant …- le coefficient X de préférence pour les billets
– la part de marché Y des autres réseaux bancaires que A
– le coefficient Z de réserves obligatoires… le multiplicateur de crédit K pour le réseau bancaire A est de
1 / [X + Y (1 - X)+ Z (1 – X - Y (1 - X))]Par exemple :
- X = 0,13 (13%)
– Y = 0,9 (soit 90%)
– Z = 0,02 (2%)On obtient une capacité de création monétaire (multiplicateur potentiel de la monnaie de base) de 1,07 pour le réseau A et de 6,48 pour les autres réseaux qui disposent d’une part de marché de 90%
Dans une hypothèse où le taux de réserves obligatoire serait de 2% et où la préférence pour les billets diminuerait à 2%, la capacité de création monétaire de crédit de l’ensemble du système bancaire dépasserait un K = 25 ; ce serait dans ce cas la limitation des fonds propres – devant être supérieurs à 8% des crédits – qui interviendrait probablement bien avant que ce chiffre ne soit atteint)
Le graphique ci dessous montre la capacité de création monétaire de l’ensemble des réseaux bancaires dans différentes hypothèses de réserves obligatoires pour une demande de billets choisie ici à 13% (mais c’est une simple constatation issue du rapport de la monnaie fiduciaire sur les crédits, qui, comme nous l’avons dit, est variable suivant la période de l’année et la zone géographique).
Dans quels cas y a t-il création monétaire par un réseau bancaire?
a) lors de l’achat d’un actif par lui-même : Escompte de traites, achat d’action, d’obligation publique ou privée, ou de biens immobiliers (actifs réels)….mais n’oublions pas les fuites auxquelles il va devoir faire face en fonction de sa part de marché.
b) lors de l’octroi d’un crédit :Crédit à la consommation, crédit à l’investissement, crédit immobilier, crédit de trésorerie, autorisation de découvert. Nous ne parlons pas ici de prêts d’épargnes antérieures existantes lesquelles ont de toute façon pour origine un crédit.
c) lors du versement de devises >(une devise étrangère est un titre de créance sur l’étranger) par un de ses clients.
A l’inverse, il y a destruction monétaire (la monnaie disparaît des comptes de dépôts) lors de la vente d’un actif, d’un remboursement d’un crédit, d’un retrait de devises, de telle manière qu’en période normale la masse monétaire totale, solde instantané des créations diminuée des destructions, croit d’une manière raisonnable.
Il faut maintenant répondre à l’objection que vous feront peut-être quelques petits banquiers (sans que ce terme de « petit » ne soit péjoratif), qui vous diront qu’ils ont besoin de « ressources » ( ensemble des dépôts) pour créer des « emplois » (prêts ou financements, charges) ?
Votre banquier vous dira qu’il ne crée pas de monnaie … pourquoi ?
Dans son activité, ce banquier, trésorier d’agence, ne s’inquiète pas de savoir s’il crée de la monnaie ou pas : le banquier-trésorier va uniquement chercher à équilibrer ses comptes à la Banque Centrale (la « banque des banques »), par rapport aux autres banques. Si sa banque prête trop par rapport aux autres, c’est le système qui va la rappeler à l’ordre, car il faudra soit qu’il s’endette auprès des autres banques (et les lignes de crédit ne sont pas illimitées), soit qu’il mobilise des actifs sur le marché monétaire (et là non plus, son bilan n’est pas inépuisable….)
1 – Au niveau d’une banque prise isolément, les deux positions suivantes correspondent à l’expérience du banquier :
a) il crée des dépôts en « achetant » (en monétisant) une créance (une reconnaissance de dette) et en payant cet achat de créance par une inscription immédiate du montant au crédit du compte à vue du client, lequel pourra utiliser ce compte pour régler ses dépenses.
b) il a quand même besoin de dépôts car il va devoir financer son déficit de trésorerie en monnaie centrale vis à vis des autres banques (si ce n’est pas le cas il devra se refinancer dans cette monnaie centrale car pour avoir des comptes équilibrés en elles, les banques doivent “marcher au même pas” entre les parts de marché de crédits et les parts de marché de dépôt ).
Donc le banquier isolé n’a pas le sentiment qu’il peut créer de la monnaie avec son stylo, parce qu’il faudra bien qu’il “finance” le prêt qu’il a accordé.
2 – Au niveau du système bancaire dans son ensemble, toutes les banques prêtent (elles font toutes le point 1a ci-dessus), et vont donc (pas forcément consciemment) se refinancer les unes les autres.
Prenons un cas très simple où la monnaie n’est composée que de dépôts bancaires (pas de réserves obligatoires ni de demande de billets de la part de sa clientèle, la seule nécessité restant la compensation interbancaire) et où l’ensemble des dépôts des clients dans tout le réseau bancaire est de 100 000.
Supposons une toute petite banque A qui fait 1% de part de marché de l’ensemble des dépôts toutes banques confondues. Les dépôts de ses clients sont donc de 1 000 et la part de marché des autres banques prises dans leur ensemble est donc de 99% de l’ensemble des dépôts, ce qui représente un total de 99 000
Supposons que cette banque A augmente ses crédits (et donc – instantanément – ses dépôts à vue) de 100 (10%). Elle va devoir financer 99 (la quasi totalité) qui part vers les autres banques (les fuites), puisque 99% des comptes à vue sont détenus par des clients dans les autres banques (toutes choses égales par ailleurs).
Mais, heureusement, les autres banques vont aussi prêter (si elles ne le faisaient pas, elles perdraient une partie de leur clientèle qui irait vers la banque prêteuse et donc des dépôts), c’est-à-dire créer des dépôts et subir des sorties qui vont aller vers les autres banques.
Supposons donc que les autres banques augmentent leurs crédits/dépôts à vue de 10% également, c’est-à-dire de 9 900. Elles vont subir globalement une fuite de 1% de 9 900 vers la banque A, soit 99.
La banque A reçoit donc ces 99 sous forme de dépôts, lesquels vont “financer” le crédit qu’elle a consenti,mais on comprend bien que le crédit qu’elle a fait >précède les dépôts.
Donc, le système bancaire dans son ensemble aura créé 10 000 de monnaie de crédit, mais chaque banquier-trésorier aura eu le sentiment qu’il les a financés par des dépôts venant des autres banques et qu’il a ainsi mobilisé de l’épargne préexistante (des « ressources »). Ainsi, le témoin extérieur de cette opération aura l’impression que ce sont les dépôts à vue qui sont prêtés, alors qu’il s’agit de création monétaire par le crédit, créant ces dépôts.
Dans ce qui précède la simplification est patente. Un réseau bancaire (« une banque »), lorsqu’il monétise des créances, est tenu de disposer :
a) Dans son bilan, de sensiblement 8% (qui peut descendre à 4%) des crédits en cours sous forme de capitaux propres pondérés formant une « base de capital » (ratio Mac Donough dans le cadre des règles de Bâle II). Il n’y a évidemment pas de dépôt de ces 8% en banque centrale, mais ce sont ces besoins de 8% de fonds propres qui expliquent l’idée que les banques peuvent créer 12,5 fois la monnaie qu’elles détiennent.
b) d’une certaine quantité de monnaie centrale correspondant à ce que l’on nomme « fuites », et qui correspond 1) à la demande de monnaie fiduciaire par le secteur non bancaire, 2) aux réserves obligatoires – montant bloqué en Banque Centrale – et correspondant à 1% des dépôts (dépôts à vue, dépôts à terme d’une durée inférieure ou égale à deux ans, dépôts remboursables avec un préavis inférieur ou égal à deux ans, titres de créances d’une durée initiale inférieure ou égale à deux ans), 3) aux besoins de compensation qui se produisent dans les cas montrés ci-dessus.
S’il est connu que l’ensemble des réseaux bancaires (puisque les compensations entre les banques s’annulent), peut émettre une quantité limitée de monnaie scripturale (reconnaissances de dettes), à partir d’une quantité donnée de monnaie centrale qu’il détient ou qu’il peut se procurer. Ce coefficient multiplicateur est connu de tous les économistes et il est égal à 1 / [X + Z (1 – X)] (avec X le coefficient de préférence pour les billets et Z celui des réserves obligatoires).
Néanmoins, dans un document récent (6 mai 2009), Patrick Artus a confirmé que les banques n’utilisaient pas totalement ce pouvoir de création monétaire : “Une porosité entre base monétaire et masse monétaire est le multiplicateur monétaire. Or, il s’est effondré. Alors que les banques européennes génèrent habituellement 4800 euros à partir de 1000 euros de monnaie banque centrale, leur capacité de création monétaire est tombée à 3500 euros depuis Lehman”.
Pour finir n’oublions pas de préciser que lorsqu’un emprunteur rembourse à sa banque, le capital emprunté (et dépensé), sa banque efface sa reconnaissance de dette : la monnaie est ainsi détruite (nous ne parlons pas ici des intérêts). En effet la création de monnaie scripturale par un réseau bancaire est stricto sensu l’inscription simultanée du montant du crédit sur le compte de l’emprunteur qui va ainsi pouvoir payer ses fournisseurs, parallèlement à l’inscription de la dette (je préfère dire « la garantie »), à l’actif du bilan de la banque. Inversement, le remboursement du prêt équivaut à la suppression simultanée de l’inscription à l’actif et du montant équivalent sur le compte de l’emprunteur (qui avait donc dû le rendre créditeur du même montant) : il n’y a pas de transfert du capital remboursé de la part de l’emprunteur vers la banque.
Je précise bien que nous avons parlé ici de la création de « monnaie » bancaire privée scripturale et non du second rôle des banques, celui de « circulateur d’épargne ». Comme l’écrit André Chaîneau : “L’étonnant est que pendant très longtemps – et peut-être même encore ! – la création monétaire a été ignorée comme élément des moyens de financement de l’économie ! En effet, la théorie limitait l’offre de fonds prêtables à n’être qu’une offre de ressources épargnées par les agents du secteur non bancaire, une offre qui ne débordait pas du cadre de ce secteur non bancaire. En conséquence, le secteur bancaire était ignoré! Mais le problème que les banques vont maintenant poser n’est évidemment pas celui de leur existence, mais celui de leur double fonction. Elles ne sont pas seulement les institutions créatrices de monnaie étudiées jusqu’à maintenant; elles sont également des institutions collectrices d’épargne. Aussi participent-elles au financement de l’économie non seulement en y injectant de la monnaie, mais également en y faisant circuler l’épargne.”
Mais, d’où vient cette épargne préalable ? Qui l’a « fabriquée » à l’origine? Je vous laisse y réfléchir
Il faut aussi répondre à deux questions souvent posées.
a) – « pourquoi les banques devraient se prêter de l’argent entre elles, ou, à défaut, se refinancer à la banque centrale si elles peuvent créer de la monnaie ?»
La réponse est simple : si elles peuvent (sous certaines conditions) créer leur propre monnaie, leurs concurrentes n’acceptent, elles, que de la monnaie banque centrale, qu’aucune banque commerciale ne peut créer. On se retrouve dans le cas explicité précédemment, à savoir que les « fuites » vers d’autres réseaux sont proportionnelles à la part de marché des dépôts. Créer de la monnaie pour elles mêmes aurait comme conséquence que cette monnaie va fuir vers d’autres banques au prorata des parts de marché de ces dernières.
b)- « pourquoi les banques, si elles peuvent créer la monnaie, peuvent-elles faire faillite» ?
La réponse est quasiment la même que celle de la question précédente. Néanmoins nous avons tenté de préciser et les réponses, un peu trop longues pour que cet article reste digeste, sont visibles sur la pagehttp://monnaie.wikispaces.com/Dette-FAQ.
Seul un système dit « à réserves pleines » (à l’origine défini par Irving Fisher sous le terme « 100% money », réactualisé par Allais et de nombreux autres économistes) qui est développé sur plusieurs articles, tel celui-ci ou celui-là pourrait permettre à la collectivité le contrôle total et la stabilité de la masse monétaire circulante, la bonne affectation de toute augmentation de la quantité de monnaie, le gain de seigneuriage, et, cerise sur le gâteau, le gel d’environ deux-tiers de la dette publique.
Classé dans:Article invité, Banques, Compléments de "postjorion", Débat monétaire, Holbecq, Monétisation Tagged:agregats, banques, BCE, création monétaire, Holbecq, monétisation, monnaie, système bancaire
11:56 Publié dans à publier, Crédit, Finance | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |